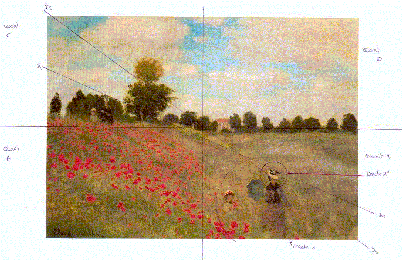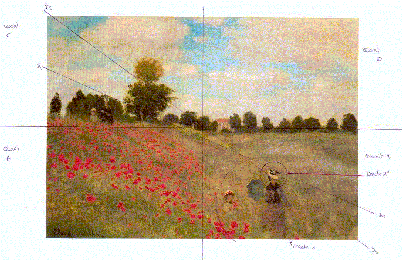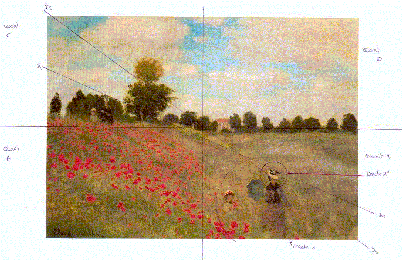
Agrandir le tableau
1.La vie de Claude Monet
A/ 1840-1864 : Son enfance et son apprentissage de la peinture.
Les coquelicots de Claude Monet est un tableau de 50 centimètres sur 65 centimètres : il a été peint en 1873 prés d'Argenteuil . Cette toile est actuellement exposée au musée d'Orsay à Paris . Ce tableau est le premier d'une série dont le thème central est les fleurs telles que les
Fleurs de Topinambours (1880) ou
Les nymphéas(1904). De même que pour ses autres tableaux , Monet utilise un style qui lui est particulier : la touche de peinture est vague et large , ce qui donne une certaine impression de flou au tableau .
Les coquelicots ont été réalisés durant une période difficile pour le peintre . En effet , ses parents désapprouvent son mariage avec Camille Doucieux et lui ont supprimé toute aide financière .
1.Description du tableau
A/Le premier plan
Au premier plan , nous voyons une femme élégante portant une robe gris - taupe . Elle a un châle noir noué au niveau de la poitrine : les deux longueurs descendent légèrement en-dessous de la taille en formant une légère courbe ondulatoire vers la droite . Cette femme a les cheveux bruns et relevés en chignon , son chapeau est en paille et comporte un ruban noir noué sur le derrière . Dans sa main droite , elle tient une ombrelle qu'elle vient soit de baisser ou qu'elle va remonter afin de se protéger du soleil : l'intérieur est gris bleu avec au centre un bleu légèrement plus clair . L'ombrelle est bordée d'une fine dentelle que l'on distingue sous une couleur ocre . La main gauche de la femme est dirigée vers l'avant , ce qui donne l'impression d'un mouvement de balancier .
En ce qui concerne l'enfant qui se trouve en retrait de la femme , il porte lui aussi un chapeau de paille jaune , avec un ruban rouge . Ses cheveux sont bruns , comme ceux de la femme. Il est vêtu d'une blouse ou d'un costume dans les teintes ocres et dont le col est bordé de noir . Nous pouvons donc supposer qu'il s'agit d'un garçon en bas âge (entre quatre et dix ans) . Il tient dans sa main gauche un bouquet de coquelicots .
La femme et l'enfant constituent un premier couple . Les deux personnages se trouvent en bas d'une colline ornée de coquelicots .
De cette première description , nous pouvons voir , qu'il y a un décalage entre la femme et l'enfant qui se traduit notamment par le fait que , les figurants tiennent tous les deux un objet mais dans une main différente . De plus , le ruban du chapeau du garçon rappelle la couleur des coquelicots alors que celui de la femme marque un véritable contraste avec le champ de fleurs : il annonce la fin de cet espace floral .
B/Le second plan
Au second plan , nous trouvons un deuxième couple semblable au premier qui se compose également d'une femme et d'un enfant .
La femme porte une robe noire ou du moins foncée dont le col est bordé d'un liseré de dentelle blanche . Elle est coiffée d'un chapeau dans les tons blancs crème et tient elle aussi une ombrelle encore repliée sous son bras droit ; sa main gauche est posée sur le manche .
De même , l'enfant qui l'accompagne porte un chapeau et une tenue dont la couleur rappelle celle du jeune garçon figurant au premier plan . Il semble lui aussi très légèrement en retrait de la femme .
Ce second couple se trouve en haut de la colline et semblent arrêtés , prêts à avancer dans le champ de coquelicots .
C/Le fond
Le dernier plan se compose d'une chaîne d'arbres de couleur brunne-verte . Un arbre se détache cependant de cette ligne : celui qui se situe en arrière et un sur la gauche du second couple . Il semble que cet arbre est subi une dernière retouche par le peintre : en effet , à son sommet , nous avons l'impression que la tache couleur marron a été rajoutée .
Au centre du tableau , la ligne d'arbre laisse apparaître une maison à étages de style bourgeois (il ne s'agit pas d'une ferme), dont le toit est rosé . A droite de la maison et derrière les arbres, nous pouvons voir une prairie d'un vert relativement foncé . Ce pré est en contraste avec les buissons verts clairs au centre du tableau . Ces buissons représentent la démarcation entre la colline de coquelicots à gauche et le vaste champ à droite dont les couleurs sont affadies et neutres par rapport au rouge vif des fleurs .
Le ciel bleu est parcouru par de nombreux nuages de couleur crème : cela nous fait penser à un ciel d'été .
Il ne faut pas oublier ce qui constitue l'essentiel de la toile: les coquelicots qui se trouvent dans la partie gauche du tableau . En effet , de haut en bas de la colline se trouve un véritable champ de coquelicots . Nous pouvons remarquer , que leur densité est plus importante à son sommet et qu'elle va de façon régressante en descendant . Les coquelicots sont plus parsemés au bas de la colline .
12. La composition , le cadrage
Afin de mieux comprendre cette explication , il est préférable de se référer au tableau les coquelicots ci-joint .
A/Décomposition du tableau en quatre parties : A , B , C et D
Si l'on décompose le tableau en quatre parties : quart A , B , C et D , nous pouvons constater que le premier couple se situe dans le quart A . Le champs de coquelicots se trouve pratiquement dans sa totalité dans le quart B qui est constitué exclusivement de fleurs . Au contraire le quart C est composé de second couple en haut de la colline , du début de la chaîne d'arbres avec à droite l'arbre dominant décrit précédemment . Enfin le quart D est constitué de la continuité de la ligne d'arbre commencé en C , et dans sa partie de gauche , de la maison .
Le quart D marque la séparation avec le champ situé dans le quart A . De même le quart C montre la démarcation qu'il y a entre le haut de la colline et le bas (B) . En ce qui concerne le quart A , il montre la fin des coquelicots , le dénivelé entre la colline et le champs brumeux se trouvant à gauche .
B/La focale
La focale est représentée par le cercle 1 qui englobe le premier couple . Nous pourrions même la préciser en la recentrant sur le chapeau de la femme , car il semble être le point de convergence d'un bon nombre de lignes que nous analyserons ultérieurement .
Ce cercle 1 représente donc le couple premier du tableau , qui hormis la présence des coquelicots constitue l'élément essentiel de la toile . En effet , la focale englobe à la fois une partie des coquelicots mais aussi une partie du champ situé à droite et enfin une partie de la délimitation de la colline . En fait , à partir de cette focale on peut deviner en quelque sorte les éléments constitutifs du tableau .
C/Les diagonales
Comme nous venons de le voir , le chapeau de la femme du premier couple (représenté par le cercle 1') , permet de tracer différentes diagonales . En effet , à partir du cercle 1' , nous pouvons construire la ligne D1 qui passe par le sommet des chapeaux des deux femmes . De même , la diagonale D2 passe aussi par le cercle 1' mais dans sa partie inférieure et rejoint le sommet de l'arbre que nous avons décrit dans la première partie.
La diagonale D1 marque la fin du champ de coquelicots alors que la diagonale D2 représente la délimitation de la colline d'avec le champ de droite qui semble plat . D2 montre bien la rupture faite par un changement de nuance progressif qui fait passer de l'ondulation de la colline à la plénitude du champ de droite. Cette deuxième diagonale qui est en quelque sorte
" une ligne d'horizon verticale "
permet de montrer une seconde ligne d'horizon ; cette fois horizontale déterminée par les arbres (donc par les limites supérieures des quarts A et B) .
De ce fait, nous pouvons conclure que le point de fuite est représenté par les arbres ou plus exactement par ceux de droite car les nuances de couleurs présentes dans le champ donnent une certaine perspective au tableau . On a l'impression que le point de fuite se continue derrière cette ligne d'arbre , dans le pré qui est vert foncé.
D/Les Lignes
Les coquelicots
sont essentiellement constitués de courbes : il n'y aucun trait linéaire . En effet , même le toit de la maison est entouré d'une sorte d'auréole de couleur rose . Les principales courbes sont celles dénotées par la colline mais aussi par la ligne d'arbres . La disposition des coquelicots forme aussi une courbe ainsi que les corps des deux couples .
2.Interprétation personnelle des coquelicots
A/La Bourgeoisie
Lorsque nous regardons ce tableau , nous voyons bien que les deux femmes appartiennent à la bourgeoisie car elles ont une tenue typique : chapeau , ombrelle , robe à manches longues …
En aucun cas , il ne peut s'agir de nourrices : ceux sont des femmes qui dénotent une certaine élégance (mouvement de balancier fait par la main) . En effet , s'il s'agissait de simples servantes , elles ne posséderaient pas une ombrelle en plus d'un chapeau .
De plus , nous remarquons que ces femmes sont accompagnées toutes deux d'un enfant qui semble être un garçon et probablement leur fils . Or ces deux garçons sont légèrement en retraits de leur mère . Ceci peut s'expliquer par le fait que les familles bourgeoises employaient des nourrices afin de s'occuper de leurs enfants et donc les enfants ne partageaient pas une réelle complicité avec leurs parents .
La relation enfants - parents à cette époque était plus dominée par une marque de respect que par un lien affectif . Il est vrai que si l'on observe attentivement le premier couple , nous remarquons que la femme est en train de marcher sans se préoccuper de son fils qui est en retrait : cela marque une certaine distance entre les deux personnages . Il en est de même pour le second couple où l'enfant est représenté avec un certain recul par rapport à sa mère.
Ce tableau en un sens nous montre comment la bourgeoisie féminine de l'époque vivait . Il semble que cette toile représente une sorte de parade où la mère se promène avec son enfant pour se mettre en valeur alors que l'enfant est relégué au second plan .
B/Rupture du lien maternel
Nous pouvons aussi interpréter le retrait des enfants comme une rupture du lien maternel . En effet , nous pouvons considérer que le peintre en mettant les enfants légèrement derrière leur mère a voulu montrer le cycle de la vie . Tout enfant, à un moment donné , doit se détacher de sa mère , peut-être que Monet en peignant ce tableau annonce une rupture certaine entre la mère et l'enfant .
Les coquelicots en ce sens seraient donc une sorte de préliminaire à cette rupture . De ce fait , en ayant placé la mère devant , le peintre aurait voulu montrer que celle-ci se détache de son enfant car elle sait déjà qu'une séparation future doit se produire. Si l'on considère cette approche , on pourrait parlait de l'inconscient de la mère mais ce serait peut-être sur-interpréter le tableau .
C/Le manque de communication
Les coquelicots nous montrent deux couples , qui comme nous l'avons vu sont constitués de la même façon . Or ces deux couples s'opposent . En effet alors que le premier est en train de marcher , le second est arrêté , le premier est au pied de la colline et l'autre est en haut , la première femme a son ombrelle ouverte alors que l'autre la tient repliée sous son bras.
L'opposition entre ces deux couples peut connoter un manque de communication . En observant le tableau on a l'impression qu'ils ne parviendront jamais à se rejoindre du fait que , l'un marche alors que l'autre est arrêté . Monet semble peindre un monde où les hommes ont du mal à communiquer .
Ce qui est frappant ici , c'est à la fois la proximité entre ces deux couples et la distance qui les sépare . Nous pourrions objecter à cela , que le premier couple ne s'est pas aperçu de la présence du second , ce qui est peu probable, car un enfant n'est pas un être
" muet "
. De plus si cela était le cas , le second couple est obligé de voir le premier puisqu'il est devant lui or, il n'y a aucune marque dans le tableau qui laisse supposer que les personnages vont se rencontrer .
Cela traduit bien ce manque de communication qui existe entre les hommes : une sorte de gêne qui empêche les gens de se parler. Ce phénomène est d'autant plus visible ici , du fait que ces deux couples sont le reflet l'un de l'autre ( même appartenance sociale et même situation familiale) donc on ne peut pas attribuer cette gêne à une différence sociale .
Les coquelicots représentent bien par le biais de ce parallèle entre les personnages , cette appréhension d'autrui .
D/La nature : un monde parfait
Ce que connote parfaitement ce tableau c'est la représentation d'une nature parfaite . En effet , Monet a peint un paysage qui est reposant , paisible et serein . Aucune trace de la technologie de l'homme n'est visible , si ce n'est la maison que l'on voit au loin.
Les personnages semblent jaillir de ce paysage , seul un léger sillon dans les coquelicots , que l'on distingue à peine montre que le premier couple est réel . Ce tableau peut nous faire penser à un rêve où les images sont parfois floues . On a l'impression qu'il s'agit d'un modèle de nature presque parfaite .
Cette idée est très bien rendue par le style du peintre, car les contours des formes sont flous . Les délimitations ne sont que changement de couleurs , tout apparaît comme faisant partie d'un monde virtuel et parfait .
De plus certaines formes telles que celle de l'arbre nous semblent imaginées . Il en est de même en ce qui concerne le champ de coquelicots qui se termine brutalement sans aucune raison naturelle . Bien que ce tableau représente un paysage des environs d'Argenteuil , on a l'impression qu'il sort de l'imagination du peintre . Ce phénomène s'explique tout simplement par le fait que , Monet a voulu exprimer ce qu'il ressentait devant ce spectacle par la peinture, de la même façon que nous essayons de le faire avec des mots.
3.Vers l'imaginaire
Afin de terminer l'analyse de ce tableau , nous allons voir que nous pouvons recréer une sorte de narration qui raconte
Les coquelicots .
Par un dimanche après midi , sous un soleil de plomb, une femme de la haute bourgeoisie décide d'aller faire une promenade en compagnie de son fils . Les deux personnages après une heure de marche ont contourné une haie d'arbres , sont parvenus au sommet d'une butte , que jonchaient des coquelicots . Là , la femme pour se protéger du soleil lève son ombrelle au-dessus de la tête et commence a descendre la colline : son fils est légèrement en retrait derrière elle . En effet , le jeune garçon s'arrête ramasser des coquelicots qu'il tient dans sa main gauche . Arrivés en bas de la butte , la femme abaisse son ombrelle, car le soleil se fait moins sentir et continue à marcher , suivie par son fils .
Au sommet de la colline apparaît alors une autre femme et son enfant : ils s'apprêtent à prendre le même chemin que le premier couple . La femme a encore son ombrelle fermée et l'ouvrira sûrement lorsqu'elle commencera à descendre la colline . De même, son fils qui semble être très jeune aura envie lui aussi de s'arrêter afin de ramasser les coquelicots dont la couleur est irrésistible pour les yeux d'un enfant . Puis , ce second couple arrivera au pied de la butte , et la femme abaissera alors son ombrelle afin de continuer sa promenade .
Pendant ce temps , le premier couple poursuit son avancée afin de contourner les arbres qui se trouvent à droite pour rejoindre la maison .
En conclusion , le tableau de Monet n'est pas aussi anodin que cela . La simplicité et la pureté du style du peintre semble figer la nature et tout ce qu'elle comporte mais connote quelques idées qui à première vue ne sont pas visibles . De ce fait , nous ne devons en aucun cas considérer l'impressionnisme et les œuvres de Monet comme de simples paysages fixant la nature . Si ce courant est dominé par des impressions , celles -ci n'excluent pas aux peintres la pensée. Dans ce cas la peinture doit être considérée comme un moyen d'exprimer sa pensée : comme un langage.